Julie a vécu plusieurs années au Japon et est devenue traductrice du japonais vers le français. Son mari, Gino, est graphiste et travaille lui-aussi sur des mangas.
Pouvez-vous vous présenter et présenter vos parcours ?
Julie : « J’ai passé une licence de japonais à l’Inalco et c’est en 2e année de licence que j’ai commencé la traduction, au début aux éditions Soleil, puis j’ai poursuivi avec d’autres éditeurs. J’ai traduit principalement du manga et un peu d’anime, notamment une partie de l’anime Naruto. Il y a quelques années, j’ai changé mon entreprise individuelle en une société, Studio Mankai, pour proposer également du lettrage. Mon mari, Gino, m’a donc rejoint en lettrage et nous travaillons ensemble avec d’autres sous-traitants. Nous proposons nos services à différents éditeurs : pour l’instant, principalement Delcourt, Tonkam, Soleil, Nobi-Nobi, Doki-Doki, Omake et Crunchyroll.
Je me suis intéressée très tôt au Japon grâce à ma famille. Mon cousin Florent Gorges est assez connu dans le milieu du jeu vidéo et du manga. Il a été l’un des co-fondateurs des éditions Omake, il avait monté Pix’n Love et il avait beaucoup participé à la chaîne Nolife. Il avait sept ans de plus que moi donc c’était lui qui m’avait initiée à cet univers. Quand il avait 17-18 ans, il est parti passer sa première année scolaire au Japon et j’ai continué de mon côté puis, dès que j’ai eu l’âge, je l’ai rejoint dans le manga. »
Gino, en quoi consiste le métier de lettreur/graphiste ? Quel est son rôle dans la conception de la version française d’un manga ?
Gino : « Pour commencer c’est de remettre le manga en page, avec toute la pagination. De remplacer le texte japonais par le texte en français. Et de refaire les onomatopées quand c’est nécessaire. Cela varie aussi selon les éditions : par exemple, certaines veulent enlever les hors-bulles, tandis que d’autres non. Parfois, on a aussi besoin de faire des retouches sur le dessin, autour des textes hors-bulles. Au niveau de la maquette certaines éditions veulent inverser complètement les images, d’autres les veulent à une certaine taille… Donc il faut avoir des mémos et pouvoir jongler entre les différentes exigences ! »
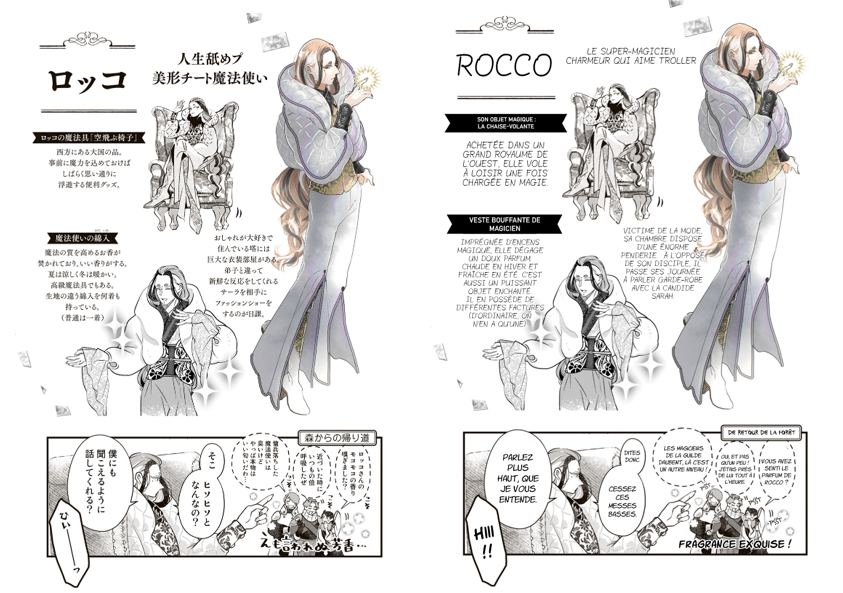
La conception d’un manga est un travail d’équipe ?
Gino : « Tout à fait. Quand je fais la maquette, je relis en même temps le manga et il arrive que je le renvoie à Julie pour corriger des détails dans le texte, puis elle me le repasse. La maison d’édition apporte aussi des modifications, refait des choses à sa manière… Donc le manga passe vraiment par plusieurs personnes pour arriver au résultat final. En général, on passe par trois ou quatre versions différentes. »
Julie : « Oui, il y a un jeu de ping-pong permanent. C’est obligatoire si on veut vraiment bien faire notre boulot. »
Quelles sont les spécificités / les difficultés de la traduction du japonais vers le français ?
Julie : « Ce qui peut être compliqué, c’est que le sujet est souvent sous-entendu dans une phrase en japonais. Il n’y a pas forcément de masculin ou de féminin, de singulier ou de pluriel… Du coup, quand c’est du suggéré ou qu’il y a un suspense quant à la personne dont on parle, on galère parfois à trouver un équivalent qui reste neutre. Car lors de la révélation dans le tome suivant, on se rendra peut-être compte qu’on est tombé à côté ! (rires) Ce n’est donc pas toujours facile, mais avec le temps on sait trouver des parades.
En japonais, on a parfois un vrai concept derrière un mot et, pour le traduire, il faudrait une phrase ! Malheureusement, on a la contrainte physique de la bulle. Qui, de plus, est prévue pour une écriture verticale. Les traducteurs débutants traduisent souvent littéralement et veulent faire de longues phrases. Mais le traducteur qui a un peu d’expérience pense justement à la galère du lettreur qui devra insérer le texte dans les bulles ! (rires) »
Gino : « Oui car ensuite on se retrouve avec une police de taille 2, c’est quasiment illisible. »
Quelles est l’expression / le jeu de mot le plus difficile à traduire que vous ayez rencontré dans un manga ?
Pour commencer, il y a toutes ces petites expressions récurrentes, de type « naruhodo » ou « yappari » – celles qu’on traduit généralement par : « Je vois », « C’est clair » ou « En effet ». Pour mieux traduire, il faudrait faire une phrase comme : « Ça tombe sous le sens. » Mais c’est beaucoup trop long et ça ne rentrerait pas dans la bulle… Et c’est insupportable, car les mangas sont truffés d’expressions de ce type ! (rires)
J’ai aussi eu le cas d’un manga fantastique, où il y avait des enfants déscolarisés – donc sans uniformes – et avec des prénoms comme « Mizuki », qui pouvaient être aussi bien masculins que féminins. Si bien que pour certains personnages à l’apparence androgyne, il était littéralement impossible de savoir si c’étaient des garçons ou des filles ! Même en faisant des recherches en japonais sur internet, on ne trouvait rien… Donc pour les pronoms personnels en français, je m’arrachais les cheveux ! »
Le métier de lettreur a-t-il évolué ces dernières années ?
Gino : « Oui, avec les outils numériques, les auteurs au Japon insèrent plus facilement des onomatopées dans leurs mangas. Il y a aussi plus de texte et plus de bulles, par rapport aux anciens mangas. Donc cela fait plus de travail pour les lettreurs et cela nous prend plus de temps. Les onomatopées sont plus complexes et, maintenant, il y a même parfois des mangas en couleurs. Nos outils évoluent aussi, mais l’IA ne fonctionne pas pour l’instant pour ce métier. »
Julie : « Les trames (arrière-plans ou motifs pré-dessinés) utilisées dans les mangas sont aussi plus complexes avec le numérique. Lorsqu’il y a un texte hors-bulle, il faut effacer et refaire la trame autour du texte, ce qui prend plus de temps aujourd’hui. »
Gino : « Oui et l’IA ne sait pas, pour le moment, reproduire les trames. Les points de trame doivent vraiment être refaits à la perfection et, si on agrandit, on peut voir que chaque point de trame est un peu différent. Donc si on veut faire un travail de qualité, cela peut prendre beaucoup de temps. »
Julie : « On dit que la technologie est censée nous aider. Mais en réalité, elle nous pose surtout des problèmes. »
L’IA est-elle un danger pour les traducteurs ? J’ai l’impression que Google Traduction ou Deepl ont plus de mal avec le japonais qu’avec d’autres langues…
Julie : « Là encore, c’est parce qu’il y a beaucoup d’implicite en japonais. En manga, on s’appuie aussi sur le dessin pour interpréter le texte, et Google Traduction ou Deepl ne peuvent pas traduire en comparant avec l’image en même temps. Il y a 9 chances sur 10 qu’ils tombent complètement à côté !
Ce qui est plus inquiétant en revanche, c’est qu’il y a des logiciels « spécial manga » qui sont prêts depuis longtemps au Japon mais qui ne sont pas encore officiellement lancés. Il y en a un qui s’appelle « Mantra » (probablement une contraction de « manga » et « traduction »). Et on raconte que sur 10 bulles qu’il traduit, il y en a 5 qui n’ont pas besoin d’être retouchées. Les 5 autres nécessitent juste quelques corrections. Donc on n’est pas encore impactés, mais ces logiciels sont prêts depuis un peu plus d’un an. »
Donc ce sont les Japonais eux-mêmes qui développent des outils pour traduire leurs mangas dans d’autres langues ?
Julie : « Exactement. Avec ces outils, ce sont les Japonais qui vont proposer leurs mangas déjà traduits aux éditeurs étrangers. Pour l’instant, le logiciel traduit en 16 langues en simultané. Ils vont donc les proposer aux éditeurs pour les versions sur papier mais, en numérique, c’est eux-mêmes qui vont poster leurs mangas directement traduits sur une plateforme.
Donc la logique voudrait que, dans quelques temps, non seulement les traducteurs n’aient plus de boulot, mais les éditions françaises non plus. Car il y a un intervalle de temps entre le moment où le manga sort au Japon et celui où il est publié en France sur papier, tandis que sur la plateforme les traductions seraient disponibles de manière instantanée. »
Mais ce seraient des traductions de plus basse qualité ?
Gino : « La traduction ne sera pas entièrement faite par une machine : on aura toujours besoin de quelques personnes pour faire marcher les logiciels et contrôler les traductions. Il y aura donc quand même un relecteur pour adapter les blagues ou les tournures de phrases au public français. »
Julie : « Il y a déjà un site de traduction simultanée au Japon, où les auteurs peuvent déposer leurs mangas. N’importe qui peut se proposer traducteur, passer par ces logiciels d’aide et recorriger un petit peu. Ces logiciels leur proposent 100 yens de rémunération à la page, donc ce n’est pas viable et il est impossible d’en faire son métier.
Quant au logiciel Mantra, ses créateurs ne sont pas bêtes : ils ont repéré dans tous les pays les gens qui faisaient de la fan-trad (c’est-à-dire qui traduisaient et postaient illégalement des scans de mangas sur internet). Et ils leur ont proposé de faire de la relecture pour leur logiciel, moyennant un micro-salaire. Ce sont des gens qui faisaient de la traduction gratuitement, à la base. Donc, même si on leur propose un salaire ridicule, ils sont contents ! »
Gino : « Mais en effet, la qualité des traductions risque de baisser car ce ne sont pas des traducteurs professionnels. Et ce logiciel va inonder aussi le marché, une fois qu’il sera mis en route. »
Julie : « Non seulement il n’y aura pas de traducteur professionnel, mais il n’y aura pas non plus d’éditeur pour relire et revérifier. Les maisons d’éditions françaises vérifient aussi qu’on est dans les clous, sociétalement parlant. Par exemple, si on édulcore les blagues sexistes dans les mangas jeunesse, c’est sur les directives des éditeurs. »
Gino : « Avec ce logiciel, les Japonais feraient d’une pierre deux coups car cela leur permettrait aussi d’éliminer la scan-trad. Peut-être qu’il y aura encore du contenu disponible gratuitement sur internet, mais alors ce seront des traductions volées à leur logiciel, pas des scan-traders qui traduisent eux-mêmes. »
Le manga numérique fonctionnerait-il bien auprès du public français ?
Julie : « Si le logiciel Mantra est prêt mais n’a pas encore été mis en service, c’est qu’il y a des raisons. Les éditions Piccoma qui proposaient des mangas en lignes n’ont pas fonctionné et ont fermé en France. Les fans français sont un public de collectionneurs : ils aiment acheter des tomes de mangas en version papier, feuilleter les mangas dans les bibliothèques ou dans les magasins, racheter leurs séries préférées en éditions Deluxe… Donc je pense qu’on a encore un peu de temps devant nous. »
Gino : « Oui, il y aura toujours des fans pour acheter des bouquins. Mais sans doute de moins en moins, car les gens aujourd’hui ont pris l’habitude de lire sur leurs portables. Et on voit déjà avec les gens qui lisent des scans-trads que les fans ne veulent pas attendre la sortie papier pour avoir les nouveaux chapitres des mangas. »
Le marché du manga se porte-t-il bien en France actuellement ?
Julie : « Pas tellement. On a eu un boom des ventes de mangas pendant le confinement. Mais après 2022, le pouvoir d’achat s’est effondré tandis que le coût des matières premières (encre, papier…) augmentait. Piccoma a fermé en 2024, ainsi que d’autres éditeurs. Il y a eu un gros recul du chiffre d’affaires et la situation est tendue. »
La France est pourtant le deuxième consommateur de mangas, derrière le Japon…
Julie : « C’est vrai. Mais il y a une différence entre les grosses licences (One Piece, Naruto, Dragon Ball…) et le reste du marché. Les shônen commerciaux se vendent très bien, mais ce n’est pas le cas des autres mangas. Cet écart s’est beaucoup creusé ces dernières années, car auparavant le public était plus curieux de découvrir des mangas d’auteurs ou des petites séries. Du coup, ce sont les petites maisons d’édition qui coulent, pas celles qui ont les grosses licences. »
Sur quels titres avez-vous travaillé ? Le groupe Delcourt prévoit prochainement la réédition du manga Frère du Japon de Taiyô Matsumoto, l’auteur d’Amer Béton…
Julie : « En effet. Mais comme il s’agit d’une réédition, je ne ferai pas la traduction. Seul Gino travaillera dessus, pour refaire le lettrage.
Le titre le plus célèbre sur lequel j’ai travaillé est l’anime de Naruto, dont j’ai traduit trois saisons. J’ai traduit la mort de Jiraiya, qui m’a fait pleurer ! Et aussi le combat de Sasuke et Itachi, qui avait une musique magnifique.
En manga, j’ai traduit Gambling School et les séries qui en sont dérivées, le yaoi Junjô Romantica, ou encore le shônen Classroom for Heroes. »
Quels sont vos mangas préférés ?
Julie : « J’aime les choses un peu didactiques. En France, on n’importe pas beaucoup ce style de manga. Mais au Japon, il y a des mangas pour apprendre à jouer aux échecs, il y a des mangas pour apprendre l’Histoire du Japon… C’est d’ailleurs comme ça que j’ai eu mon partiel d’Histoire ! (rires) Ça commence un peu à arriver en France : j’ai par exemple traduit des mangas qui faisaient découvrir des concepts philosophiques. Mais il n’y en a quand même pas beaucoup, alors que c’est ceux que je préfère.
Je pense que ce style de mangas mériterait plus d’attention de la part des éditeurs. Surtout qu’aujourd’hui il y a beaucoup d’adultes en France qui lisent des mangas, pas seulement des jeunes. Or on continue de traduire plutôt des histoires fantastiques ou des titres pour la jeunesse. Et lorsqu’on parle de mangas pour adultes en France, il s’agit surtout de mangas érotiques. Alors qu’il existe beaucoup d’autres choses. »
Gino : « Moi je suis plutôt sur du shônen. J’aime les choses un peu légères, les mangas comme Classroom for Heroes. J’ai plus une lecture jeune et, quand je vais dans une librairie, j’adore voir les enfants se précipiter sur les mangas, parler des personnages, dire : « Lui, c’est mon héros ! »… Je trouve ça vraiment sympa. »
Racontez-nous votre Japon ! Quels sont vos souvenirs marquants de ce pays ?
Julie : « J’ai beaucoup de bons souvenirs au Japon. J’y ai passé une année de lycée quand j’avais 17 ans. Et j’ai vraiment atterri dans ce que l’on voit dans les anime : un lycée privé, bouddhiste, avec que des filles, et où j’étais la seule étrangère ! Imaginez 2000 filles et une seule étrangère, dans le Japon d’il y a 20 ans ! C’était une expérience absolument fabuleuse.
Tous les gros clichés qu’on peut voir dans les anime, on les avait ! On avait même une fois par trimestre un « contrôle des cheveux », pour vérifier qu’on n’avait pas de teinture, de boucles d’oreilles ou de maquillage, qu’on n’avait pas retroussé nos jupes et que nos cheveux étaient assez longs pour être attachés. On se mettait en ligne et j’étais toute dernière, car nous étions classées par ordre alphabétique et j’étais inclassable, ayant un nom étranger. Mais, comme je faisais plus d’1,70 m, mes profs étaient tous plus petits que moi et n’osaient pas me toucher, donc ils n’ont jamais rien contrôlé ! (rires) De toute façon, je respectais les normes de l’école.
Comme dans les mangas, également, on avait des chaussons à l’intérieur de l’école. (Car au Japon, on enlève ses chaussures à l’intérieur d’un bâtiment.) Et le bout des chaussons avait une couleur différente selon les classes. …Sauf que je fais du 41 et qu’il n’y avait pas de chaussons à ma taille ! Comme c’était un lycée de filles, il n’y avait pas de pointures pour hommes et ce n’étaient que des très petites tailles. J’ai pris la plus grande taille qu’ils avaient mais je ne rentrais pas dedans : j’ai essayé au début mais j’avais les pieds qui saignaient, ça ne marchait pas. Finalement, j’ai écrasé les talons et je les ai mis comme des claquettes, ce qui faisait un bruit pas possible quand je marchais ! Du coup, je me suis fait engueuler par tous les profs du lycée et il a fallu que je leur explique à chaque fois que je ne pouvais pas faire autrement. (rires) Au bout d’un mois, ils ont fini par comprendre.
Après le lycée, j’ai aussi vécu quelques années en plein Tôkyô, dans le quartier où il y a aujourd’hui la Skytree. (Mais elle n’était pas construite à l’époque.) À cette époque, c’était une vraie « shitamachi » et il y avait très peu d’étrangers. On entendait encore passer, toutes les nuits à 22h, un type qui claquait des bouts de bois dans ses mains et qui criait de faire attention au feu (« Hi no youjin ! »). Ça vient de l’époque Edo où tous les bâtiments étaient en bois, ce qui fait qu’il y avait de grands risques d’incendie. Dans tous les quartiers, il y avait des veilleurs de nuit qui hurlaient « Hi no youjin ! » pour dire de faire attention et de ne pas s’endormir avec un feu dans la maison. Bien sûr, il n’y a plus ça aujourd’hui et c’est devenu un quartier très moderne. Mais, il y a 20 ans, c’était encore comme ça.
On pouvait aussi remarquer que les gens du quartier étaient tous très bien habillés chaque 30 ou 31 du mois. Car c’était le jour où les patrons allaient distribuer les paies aux salariés. (Elles étaient souvent données en liquide, dans ces petites entreprises de quelques salariés.) Au Japon, il y a le « Ômisoka » (le 31 décembre, le Réveillon du nouvel an), mais il y a aussi des petits « misoka », terme qui désigne le dernier jour du mois, et donc aussi celui de la paie. Et tous les petits patrons s’habillaient bien ce jour-là, pour aller donner leurs paies aux salariés. Mais, ça aussi, je suppose que c’est différent aujourd’hui, car désormais les salariés sont payés par virements. »
Gino : « J’ai également plein de souvenirs du Japon. Mais je n’y ai fait que de courts séjours, je n’y ai pas vécu. C’est Julie qui m’a fait découvrir le Japon. La première fois que j’y ai été, c’était un énorme choc culturel car je n’avais jamais voyagé aussi loin. Mais je m’y suis senti à l’aise quasiment tout de suite, même si je ne parlais pas la langue. Ce qui m’a le plus marqué là-bas, c’est le sentiment de bien-être, le sentiment d’appartenir à une communauté – chose que, je trouve, on n’a plus réellement en France –, le fait de pouvoir se promener le soir à n’importe quelle heure sans aucun problème, l’amabilité des gens – qui viennent nous aider tout de suite s’ils voient qu’on est perdus, qui sont prêts à nous ramener même si ça leur fait faire un détour de 5 km… C’est quelque chose que je trouvais vraiment magique. Le fait aussi, à Tôkyô, de pouvoir trouver des quartiers avec des énormes bâtiments et d’autres avec des petites maisons, de voir des personnes âgées cultiver leurs fleurs, le devant de leurs maisons… Et la culture japonaise elle-même, je la trouve fantastique. Il y a partout un mélange de l’ancien et du moderne. De plus, c’est quelque chose que je n’ai jamais retrouvé en France, d’être aussi aimables et serviables au quotidien. Je pense que ce serait fantastique d’y vivre. »

Laisser un commentaire